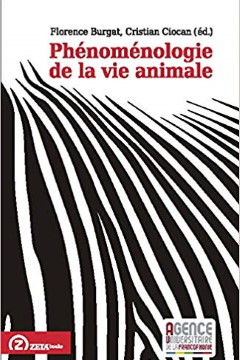0Ce livre se propose d’aborder la question de l’animalité sous un angle original. Plutôt que de trouver racine dans une problématique éthique du rapport à l’animal qui consiste le plus souvent à se demander si une conduite éthique à son égard doit ou peut être motivée par le fait que l’animal est objet d’action éthique pour l’homme, cet ouvrage choisit de faire de la question de l’animalité un problème phénoménologique à part entière. Dès lors, il n’est plus ici seulement question d’interroger la nature du rapport de l’homme à l’animal ou de l’animal à l’homme, mais d’interroger la place de l’animal à l’horizon d’un monde de sens.
0Chaque auteur participe brillamment à cette entreprise qui souffle un vent frais sur le domaine des études philosophiques concernant la question de l’animalité sans pour autant en ignorer l’héritage. Aussi, on ne manque pas de lire dès l’introduction que « [la phénoménologie] doit faire dès le début abstraction de toute compréhension traditionnelle de l’animal » (Burgat & Ciocan : 2016, 8).
0Cet ouvrage se compose de trois sections distinctes. La première, intitulée « Apparence, Mouvement, Expressivité », se propose d’étudier l’animalité comme forme expressive de vie. Au lieu de partir du postulat selon lequel l’animalité constituerait un degré inférieur ou intermédiaire sur l’échelle d’un concept de vie subdivisé en trois grandes familles distinctes (le végétal, l’animal et l’humain), cette première partie considère la vie animale comme un niveau d’expressivité du vivant non moins dépourvu de sens que l’est le monde de l’homme.
0Le premier article, écrit par Benjamin Berger, se propose d’examiner le problème de la vie comme manifestation dans les écrits de Raymond Ruyer et d’Adolf Portmann. Il en résulte une analyse de la valeur attribuée à la manifestation des apparences dans le règne animal prenant le contre-pied des approches strictement génétiques et conservatrices. Contrairement à l’idée Darwinienne selon laquelle la sélection naturelle entraîne la pérennité des formes, Berger argumente avec Portmann que c’est l’apparaître qui détermine l’apparence du vivant, et non pas un simple souci de conservation ou simple rapport au milieu. Ce n’est donc pas simplement la survie qui dicte l’apparaître du vivant mais l’apparaître du vivant lui-même qui conditionne et dépasse le rapport du vivant à son environnement : en ce sens, la lecture qu’offre Berger de Portmann, Ruyer puis Merleau-Ponty questionne le problème de l’intentionnalité animale qu’il appelle « autoprésentation ». C’est l’autoprésentation elle-même qui, dès lors, va conditionner le mode d’apparaître du vivant et non l’inverse : on ne peut donc lire, selon une logique néo-darwinienne, l’apparence que prennent les animaux comme un symptôme d’un rapport prédéterminé à l’environnement. C’est au contraire parce que l’apparaître animal est toujours déjà en excès des formes qu’il peut prendre qu’il peut nous apparaître surprenant. C’est en ce point précis que le concept d’apparition remplace celui de manifestation : si la perception humaine semble comprendre chez l’animal les symptômes d’une manifestation (et donc du déploiement d’un rapport au monde prédéterminé), le concept d’apparition montre que l’animal, en tant que vivant, dépasse ce cadre de prédétermination.
0La seconde contribution, écrite par Josef H. Reichholf, poursuit la ligne tracée par la première et interroge la pertinence de la théorie darwinienne de l’adaptation pour expliquer l’expression de la beauté dans le règne animal. Là où cette dernière est traditionnellement perçue comme atout pour l’union, l’accouplement et la reproduction et mènerait à penser que la beauté de l’animal est signe extérieur de supériorité, Reichholf lecteur de Portmann avance au contraire l’idée que les formes encouragées par la sélection naturelle sont le fruit de mécanismes intérieurs. Ce n’est donc plus l’adaptation à l’environnement qui dicte la manifestation voyante de la beauté animale. Au contraire, cette dernière marque la possibilité d’une prise de distance et d’une autonomie de l’animal vis-à-vis de celui-ci. L’auteur démontre que c’est l’animal qui a s’est davantage montré capable de survivre dans un environnement dont il surmonte les contraintes (en affirmant une beauté ni strictement protectrice ou utile) qui remporte l’épreuve de la sélection sexuelle.
0Le troisième article, écrit par Nicolas Zaslawski, se propose de dégager un niveau de sens commun à la chose naturelle, à l’organisme et à autrui en-deçà du concept de représentation de manière à montrer que le niveau de compréhension que chacun partage intervient avant intellection ou la saisie par le concept kantien. Aussi, c’est le concept de forme qui devient le dénominateur commun aux êtres naturels. Zaslawki complète sa lecture de Portmann avec celle de Merleau-Ponty et insiste sur le fait que l’animal doté de monde n’en requiert ni la connaissance, ni la conscience objective. C’est le rapport toujours ouvert entre un être animal et le monde qu’il habite – rapport qui précède toujours déjà la conscience – qui permet de penser le vivant comme horizon de sens en tant que corporéité.
0Le dernier article de cette première section, écrit par Annabelle Dufourcq, étudie l’analyse du mimétisme chez Portmann à la lumière de Merleau-Ponty. Celle-ci permet de remettre en question l’approche scientifique de compréhension du mimétisme animal afin de comprendre que les cas de mimétisme observés chez les animaux sont autres qu’imitation du comportement humain. L’auteure s’appuie sur la lecture de Portmann par Merleau-Ponty pour montrer que l’animal est expression et communication d’un sens qui n’est pas celui que lui prête son observateur mais bien celui d’une intention liminaire propre à l’animal lui-même. C’est pourquoi l’auteure attire notre attention sur la dimension onirique qui peuple l’imaginaire humain à l’égard de l’apparence prise par certains animaux : le sens qui échappe à la rationalité humaine n’est pas strictement disqualifiant mais appartient à une expressivité animale primordiale qui excède toute compréhension anthropocentriste.
0La seconde section de cet ouvrage, intitulée « Vie et Existence », met l’accent sur l’analyse du seuil supposé séparer l’existence animale de l’existence humaine d’un point de vue phénoménologique. Va-t-il de soi, comme on le dit souvent à la lecture de Heidegger, que les animaux sont pauvres en monde car ils évoluent dans un domaine de sens limité qui échappe à l’angoisse existentielle et à la possibilité d’une ouverture indéterminée ?
0C’est dans cette perspective que le premier article, écrit par Christiane Bailey, se propose de remettre en question l’idée souvent trop vite reçue selon laquelle Heidegger a toujours refusé l’horizon d’un monde aux animaux. L’auteure s’appuie sur la proximité des lectures du jeune Heidegger (avant Être et Temps) et d’ Aristote (de De Anima notamment), pour montrer que le premier a développé l’analyse d’un rapport esthétique au monde qui précède la compréhension intellectuelle à laquelle il reviendra encore au Dasein d’échapper. Aussi, à regarder de plus près les écrits de jeunesse de Heidegger, Bailey nous montre que les animaux se meuvent dans un monde qui précède la compréhension intellectuelle et parviennent à faire sens en-deçà d’une rationalisation strictement humaine. L’auteure dégage donc un sol commun de compréhension partagé à la fois par l’animal et l’homme par lequel l’animal (au sens large) « s’y connaît », c’est-à-dire établit une rapport pratique, esthétique et immédiat dans le monde par le biais du mouvement.
0Le second article, écrit par Dragoş Duicu, s’attaque à la question de la différence anthropologique au moyen du concept de « tendance » chez Patočka. Ce concept permet d’aborder la question de l’animalité du point de vue d’une phénoménologie dite « asubjective » : ce n’est plus l’ego qui fonde alors l’appréhension phénoménologique mais une appréhension phénoménologique dont le sujet n’est plus que le résultat. Ceci permet à la fois de séparer les conditions d’entrée dans l’apparaître du concept de subjectivité et de permettre en même temps à ce mouvement d’excéder le cadre d’une subjectivité déterminée. Ce mouvement de recul et de dépassement permet à l’auteur de trouver chez l’animal la possibilité d’un rapport au monde proprement phénoménologique. C’est l’animal, non limité par le carcan du rapport à soi, qui peut ainsi au mieux établir un rapport au monde avant et après toute compréhension rationnelle permettant tout en même temps son ouverture toujours maintenue.
0Enfin, la troisième contribution à cette section, écrite par Florence Burgat, interroge la possibilité de rapprocher le concept d’angoisse de la condition animale. L’auteure commence par interroger le concept d’angoisse que la phénoménologie applique d’ordinaire strictement à la condition humaine. C’est l’homme qui, ne semblant pas avoir de place préétablie dans le monde qu’il habite, paraît toujours en excès de sa propre finitude. Burgat remet en question ce postulat reçu par la tradition en s’appuyant sur Husserl, Merleau-Ponty et Simondon. L’angoisse ne se situe plus simplement au moment de l’émergence d’une subjectivité proprement humaine mais au moment d’une individuation antérieure qui sépare le vivant de l’apeiron primordial. C’est la rémanence du pré-individuel qui, selon Burgat avec Simodon, permet de rendre compte des émotions. Or, cette rémanence pré-individuelle ne concerne pas uniquement la condition humaine mais aussi animale. Cette rémanence possède une dimension historique qui dépasse l’individu (animal ou humain) dont il est question, ce qui permet à Burgat, lectrice de Barbaras, de conclure que le désir n’est pas un donné proprement subjectif mais le mouvement du vivant qui s’individue.
0Enfin, la dernière section de cet ouvrage, intitulée « Approche Analogique, Approche Empathique », pose le problème du rapport humain-animal non pas en de manière à en questionner la frontière, mais afin de dégager la possibilité d’un monde commun à l’homme et à l’animal à la fois malgré et au moyen de cette frontière.
0Pour ce faire, le premier article écrit par Cristian Ciocan interroge la possibilité d’un champ commun de normalité pour soutenir le rapport humain-animal. Non pas que la normalité possède une réalité empirique a priori, mais qu’elle procède d’une projection transcendantale opérée par l’homme lui-même. Aussi, c’est l’homme, dans sa saisie de l’animal comme objet, qui établit la normalité de l’animal qu’il observe. Ce constat permet à Ciocan de poser la question d’un rapport au normal et à l’anormal au sein même de l’animalité proprement dite. Si la décision de normalité procède d’un rapport à une corporéité différente de celui qui perçoit (qu’il s’agisse d’une corporéité animale ou humaine), il devient possible de présumer que le rapport à l’anormalité se vit également au sein même de la sphère animale.
0La seconde contribution de cette section, écrite par Nathalie Frogneux, pose le problème d’une ontologie du vivant chez Hans Jonas. Cette ontologie du vivant a pour caractéristique de saisir que l’animal occupe chez Jonas une place spécifique et décisive. L’animal, perçu comme syndrome, est à la fois signe et processus inachevé : il permet à la fois d’établir une continuité ontologique au sein du vivant (entre le végétal et l’humain) et de marquer ce qui n’est pas encore exprimé. Ainsi, l’animal est condition herméneutique du vivant (il permet de comprendre comment il dessine une trajectoire depuis les organismes primitifs) et ouverture d’un indéterminé : l’animal est l’exemple d’un gain ultérieur de liberté qui, s’il permet de penser une continuité ontologique du vivant, caractérise aussi une discontinuité phénoménologique propre à tout ce qui vit et vise à se dépasser.
0Enfin, le denier article de cet ouvrage repose sur l’analyse philosophique d’une œuvre de fiction. A travers la lecture du roman Animal du Coeur d’Herta Müller, Laura Tusa-Ilea cherche à déterminer la nature de l’affect qui sous-tend les relations entre les hommes et les animaux. Parler d’affect, c’est refuser comme le fait l’auteure de se poser le problème de la continuité ontologique entre l’animal et l’homme. S’il s’agit pourtant de continuité, Tusa-Ilea la trouve dans un rapport primordial au monde, une « vie nue » qui apparaît dans les cas de solitude forcée par certains régimes totalitaires qui désolidarisent les hommes d’une cause commune. Paradoxalement, c’est cet isolement qui permet à l’auteure d’affirmer que l’homme qui renoue avec la vie nue d’animal isolé retrouve le sol commun que partage tout vivant. Or, il s’agit d’un sol commun qui ne repose pas sur le postulat biologique d’une vie nue (pour parler comme Agamben) mais sur le rapport à une altérité proprement distante et différente. Ainsi, l’auteure pense un commun extra-politique de la manière la plus originale qui soit : non pas le commun métaphysique fondé par la raison mais un commun phénoménologique qui fonde l’égalité par le concept irréductible de différence. Il n’est alors pas surprenant de constater que l’auteure cite Foucault et l’idée d’un rapport à l’altérité radicale (le fou) au-delà de l’exigence ontologico-politique de la co-appartenance au domaine connaissable de la raison.